Le replay
Nos invités experts
Pour nous guider dans cette exploration avec Anaïs Le Digarcher, nous nous appuyons sur la double expertise de :
- Adrien Chignard : Psychologue du travail et des organisations, il dirige depuis 12 ans le cabinet Sens et Cohérence. Fort de plus de 2000 interventions en entreprise et enseignant universitaire, il est un spécialiste reconnu des liens entre santé, changement et organisation.
- Séverine Bavon : Après 10 ans comme salariée dans la publicité, elle a fondé Acracy, une entreprise qui accompagne les annonceurs dans l'optimisation de leur structure créative. Forte de son expérience de dirigeante et de sa collaboration avec une large communauté de freelances, elle analyse les dynamiques du travail dans sa newsletter, CDLT.
En un coup d'œil
Ouiiiiiiii, je sais, vous avez vu le sommaire, vous avez commencé à scroller et vous vous êtes dit mais sacre bleu ! Cet article est méga long.
Et bien vous avez raison, et c’est un choix. Ce qui s’est dit est tout simplement incompressible.
Mais voici l’essentiel en 8 points clés :
- Le constat est là : Les professionnels des RH sont massivement touchés par l'épuisement, avec 81% se disant proches du burn-out. Ce n'est pas de la simple fatigue (un besoin de repos après un effort payant), mais de l'épuisement (un effort intense sans résultat probant).
- Les causes sont systémiques, pas individuelles : L'épuisement des RH provient de facteurs organisationnels comme les changements constants ("change fatigue"), leur position de "tampon" entre direction et salariés, une triple charge (opérationnelle, émotionnelle, mentale) et un manque criant de reconnaissance.
- La culture du travail aggrave le problème : La tendance à minimiser la souffrance psychologique ("on n'est pas à la mine") et la pression des réseaux sociaux qui glorifient la surperformance créent un climat où il est inacceptable de montrer sa vulnérabilité.
- La responsabilité incombe à l'employeur : Les solutions superficielles (yoga, etc.) sont inefficaces. La véritable solution est structurelle et passe par la prévention primaire : repositionner les RH comme une "charpente" stratégique de l'entreprise, investir dans leur formation et leur fournir les ressources nécessaires.
- Les leaders doivent être exemplaires : Par exemple, un manager qui prône la déconnexion mais envoie des emails le week-end anéantit toute politique de bien-être. Le principe est simple : "les gens ne font pas ce que vous dites, ils font ce que vous faites".
- La récupération active, une action basée sur la science : Pour lutter contre la saturation mentale, la Théorie de la Restauration de l'Attention (ART) montre l'importance de la récupération fréquente. Une action concrète issue de ce principe, comme une marche de 45 minutes dans la nature à la mi-journée, restaure l'énergie cognitive et peut augmenter la performance de plus de 50%.
- Le sommeil : déconstruire le mythe du surmenage et privilégier la régularité. La "mythification" des dirigeants qui se vantent de peu dormir envoie un message néfaste à tous. Cette culture de l'endurance nie le besoin humain fondamental de repos. Par conséquent, il est rappelé que tenter de "rattraper" son sommeil le week-end est contre-productif. Le principe essentiel est celui de la fréquence sur l'intensité : le corps a besoin de régularité, car le sommeil ne peut être mis en réserve pour compenser un manque accumulé.
- Le collectif est le remède ultime : Face à l'isolement, la solution la plus puissante est de briser la solitude en se connectant à ses pairs. Créer un "village d'Astérix" où l'on peut partager ses difficultés en toute sécurité psychologique est essentiel pour se ressourcer activement.
Et là, vous vous dites : "eh bien finalement, j'ai envie de lire la suite". Bonne nouvelle, cette synthèse, même si elle est longue, se lit dans l'ordre, dans le désordre, à votre guise.
Le constat sur l'épuisement des professionnels des Ressources Humaines
Sans transition, le sujet principal de la discussion : le bien-être des professionnels des Ressources Humaines (RH) et la question de l'épuisement professionnel. Anaïs révèle d'emblée que la réponse à la question “est-ce que les RH vont bien ?” est négative.
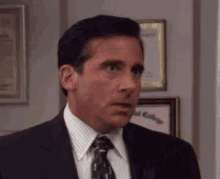
Pour étayer ce constat, elle cite des statistiques alarmantes. Un baromètre RH de 2024 (Tissot et Payfit) indique que 81 % des RH se disent proches de l'épuisement, 73 % se sentent frustrés et 66 % isolés. Une étude plus récente de la plateforme Teale montre que 38 % des RH envisagent de quitter leur entreprise cette année pour préserver leur santé mentale, un chiffre en hausse de 5 points par rapport à 2024.
Anaïs confirme que ces chiffres correspondent aux témoignages qu'elle recueille quasi quotidiennement auprès des professionnels du secteur.
La différence entre fatigue et épuisement et l'impact des changements constants
Adrien Chignard explique la distinction conceptuelle cruciale entre la fatigue et l'épuisement.
- La fatigue, illustre-t-il avec l'exemple d'une longue balade à vélo, est une lassitude physique et psychique qui suit un effort ayant abouti à un résultat. Elle se résout par le repos.
- L'épuisement, en revanche, survient lorsque l'on fournit un effort intense sans obtenir de résultat probant, comme pédaler sur un vélo sans chaîne. C'est pourquoi, insiste-t-il, le repos n'est pas une solution à l'épuisement ; suggérer à une personne en burn-out de simplement se reposer est à la fois inefficace et brutal.
Il identifie une cause majeure de l'épuisement des RH : l'hyperfréquence des changements organisationnels, un phénomène que les Canadiens nomment change fatigue. Il observe dans les grandes entreprises des réorganisations constantes (externalisation, création de centres de services partagés, rationalisation) tous les 24 à 36 mois.
💡 Il utilise une analogie domestique pour illustrer son propos : si la décoration et l'aménagement de sa maison changeaient tous les jours, on finirait par être épuisé par le manque de stabilité et l'effort constant d'adaptation. Cette surcharge de changements vide progressivement les capacités d'adaptation des individus, menant de la fatigue à l'épuisement.
La fonction RH au cœur des tensions et la perception individuelle d'un problème systémique
Séverine Bavon réagit aux chiffres en affirmant que ce constat est à la fois méconnu et évident. Elle explique que le monde du travail est structuré par des tensions entre les objectifs des entreprises et les aspirations des salariés. Aujourd'hui, ces tensions s'exacerbent, notamment entre une quête de productivisme et une recherche de sens, de temps et de contrôle sur son travail.
La fonction RH se retrouve précisément au milieu de ce conflit, agissant comme médiateur, porte-parole et cherchant une troisième voie entre un mal-être grandissant des employés et des contraintes économiques et sociales de plus en plus fortes.

Elle enchaîne sur une observation clé concernant la perception de l'épuisement. Le premier réflexe, face à ce sentiment, est de le considérer comme un problème individuel, puisque ressenti individuellement. On pense alors qu'il suffit de se reposer et, si cela ne fonctionne pas, on a tendance à se sentir coupable. Séverine souligne qu'il est crucial de reconnaître les nombreuses dimensions structurelles et les forces systémiques qui contribuent à cet épuisement, afin de sortir de cette vision où l'individu se sent seul et entièrement responsable de sa situation.
L'hypernormalisation et la minimisation de la souffrance au travail
Anaïs fait le lien avec un concept abordé par Séverine dans une de ses newsletters : la normalisation de la souffrance au travail. Elle explique que la tendance à vouloir relativiser sa situation en se disant qu'il y a plus grave est un facteur qui pèse lourdement et peut même aggraver l'épuisement.
Séverine développe ce point en introduisant le concept d'”hypernormalisation”, formulé par l'anthropologue américain d’origine russe et professeur d'anthropologie à l'Université de Californie à Berkeley, Alexei Yurchak. Ce concept servait à décrire la situation en URSS dans les années 1970-80 où, bien que l'effondrement du système était devenu une évidence pour tous, la société continuait de fonctionner comme si de rien n'était.
Poursuivant son explication du concept d'hypernormalisation, Séverine l'applique au contexte professionnel actuel. Elle compare la situation contemporaine au fait de devoir continuer à travailler sur des présentations et sous la cadence de la course aux objectifs (KPI) tout en étant bombardé de notifications anxiogènes sur l'état des entreprises, du pays et du monde. Face à cette dissonance et en l'absence d'alternative claire, les individus maintiennent une façade de normalité, ce qui est une réaction humaine mais profondément épuisante.

Elle aborde ensuite le sujet de la relativisation de la souffrance, particulièrement prégnant dans les métiers du secteur tertiaire. Des expressions courantes comme “on n'est pas à l'usine” ou “on n'est pas à la mine“ sont souvent utilisées pour minimiser la détresse psychologique.
Cette attitude conduit à une normalisation par le bas, où la souffrance dans les métiers moins pénibles physiquement est perçue comme ayant moins de valeur ou d'importance. Pourtant, cette minimisation se heurte à une réalité statistique : la souffrance psychologique est en augmentation constante dans toutes les catégories de métiers.
La dissonance émotionnelle et les dangers du surface acting
Adrien rebondit sur l'idée de maintenir une façade en introduisant le concept psychologique de surface acting (comédie de surface).
Pour les professionnels des RH, cela se traduit par l'obligation d'incarner la voix de la direction, en affichant un visage enjoué, confiant et serein, quelles que soient leurs véritables émotions.
Ce décalage entre le ressenti interne et l'expression externe crée une dissonance émotionnelle.
Il alerte sur les conséquences graves de ce comportement sur le long terme.
Le surface acting peut mener au deep acting, un état de déconnexion émotionnelle si profond que l'individu devient incapable d'identifier ce qu'il ressent. D'un point de vue psychiatrique, cette déconnexion est très préoccupante.
Ce processus génère non seulement un mal-être, mais aussi de la culpabilité, alimentée par des années de discours d'entreprise sur la nécessité de ré-enchanter le monde du travail. Adrien critique cette rhétorique, la jugeant déconnectée des besoins fondamentaux des salariés, qui attendent avant tout des moyens pour travailler, de la reconnaissance et des perspectives, comparant le ré-enchantement à une cerise sur un gâteau qui n'aurait ni farine ni œufs.
La triple charge des RH et la fatigue compassionnelle
Adrien Chignard identifie une triple charge qui pèse spécifiquement sur les professionnels des RH.
Il s'agit d'une charge opérationnelle (une surcharge de travail), d'une charge émotionnelle (la gestion d'événements humains difficiles comme les licenciements ou les restructurations) et, en raison de la forte féminisation de la fonction, d'une double charge liée au rôle sociétal des femmes, qui assument souvent une charge mentale et parentale plus importante à la maison.
Cette accumulation de charges mène à un phénomène de fatigue compassionnelle.
La fonction RH est perçue comme une fonction du cœur, devant faire preuve d'une bienveillance et d'une écoute constantes. Cependant, l'absorption continue de la détresse des autres finit par saturer leurs capacités émotionnelles.
📌 Ce qui peut être perçu comme un refroidissement ou une indifférence de la part des RH est en réalité souvent un mécanisme de protection, une forme de désimplication psychique (le John Wayne syndrome) pour se préserver d'un environnement devenu délétère.

La fatigue décisionnelle et le manque de reconnaissance
En plus des charges précédentes, Adrien ajoute la fatigue décisionnelle. Les RH sont submergés par un flux incessant d'informations complexes (mails, messages, réunions) qui exigent des prises de décision constantes. Le cerveau humain n'étant pas capable de traiter efficacement un tel volume, le travail est fait dans la précipitation, ce qui génère des erreurs, du travail supplémentaire et, finalement, un sentiment d'épuisement car l'effort ne produit pas de résultats satisfaisants.
Enfin, il souligne que la fonction RH est malade de la reconnaissance. C'est un service qui est pointé du doigt lorsque les choses vont mal, mais rarement félicité lorsque tout se passe bien, le crédit étant alors attribué aux centres de profit. Or, la reconnaissance et le soutien social sont des remparts essentiels contre le burn-out. L'isolement et ce déficit chronique de reconnaissance aggravent la situation. Il compare cela au métier de gestionnaire de paie qui n'est jamais remercié pour un bulletin correct mais vivement critiqué à la moindre erreur.
Le cocktail final, composé de dissonance émotionnelle, de fatigue compassionnelle et décisionnelle, et de manque de reconnaissance, est donc particulièrement amer.
L'image négative de la fonction RH dans les médias et les réseaux sociaux
Anaïs appuie les propos d'Adrien sur le manque de reconnaissance en citant plusieurs exemples récents où la fonction RH a été publiquement critiquée et tournée en dérision dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elle évoque l'histoire d'une responsable RH surprise en train de discuter d'un licenciement à voix haute dans un train, celle d'un mail de refus envoyé à 340 candidats sans cacher leurs adresses, ou encore une rumeur concernant la vie privée d'une RH et de son dirigeant. Ces anecdotes, qui ont fait le buzz, illustrent comment la fonction est souvent mise sur le devant de la scène de manière négative, renforçant le cycle de blâme et l'absence de reconnaissance positive.

La culture de la performance et la responsabilité des réseaux sociaux
Anaïs se questionne sur la responsabilité des plateformes comme LinkedIn dans la culture du travail. Elle observe que le réseau social professionnel valorise une culture de la surconnexion et de la performance constante.
📌 Elle cite un extrait de la newsletter de Séverine, CDLT, qui décrit un schéma courant : une personne projette une image de succès pendant des années, pour ne révéler que bien plus tard les difficultés et la souffrance vécues en coulisses, et ce, uniquement après avoir réussi à rebondir.
Cette dynamique renforce l'idée qu'il n'est pas acceptable de montrer sa vulnérabilité ou de parler de sa souffrance au moment où on la vit. Cela rejoint la situation des professionnels des RH, qui se sentent contraints de cacher leur mal-être et de continuer à sourire.
La pression ne vient donc pas uniquement de l'entreprise, mais aussi d'une culture sociétale plus large, amplifiée par les réseaux sociaux, qui décourage l'expression des failles.
Le RH comme figure symbolique et employé sandwich
Interrogée sur cette responsabilité sociétale, Séverine acquiesce. Selon elle, lorsque les gens critiquent violemment un professionnel des RH pour une erreur, ils s'attaquent moins à la personne qu'au symbole qu'elle représente.
Dans de nombreuses organisations, la fonction RH est utilisée par la direction comme un "tampon" pratique, destiné à absorber le mal-être et les difficultés des salariés. Les RH se retrouvent alors dans une position d'employés sandwich, pris en étau entre les attentes souvent déconnectées de la direction qui exige toujours plus d'efficacité, et le mécontentement croissant des équipes sur le terrain.
.gif)
Bien que la grande majorité des professionnels RH s'investissent avec une énergie considérable pour aider les salariés, la fonction devient, par sa position symbolique, une cible facile face à l'augmentation des tensions dans le monde du travail. Séverine estime que des discussions publiques comme ce live sont essentielles pour humaniser la fonction et aider à dissocier les personnes du symbole qu'elles incarnent.
La responsabilité du positionnement de la fonction RH
💬 Une question de l'audience est alors posée : le mal-être des RH ne viendrait-il pas de leur mauvais positionnement dans l'entreprise (manque de budget, de reconnaissance, etc.) et ne serait-ce pas à eux de se repositionner ?
Anaïs note que cette question illustre parfaitement la tendance à rejeter la responsabilité sur l'individu qui souffre, plutôt que de questionner la culture de l'entreprise.
Adrien analyse cette question sous deux angles.
- D'abord, il l'identifie comme une erreur fondamentale d'attribution causale, un biais cognitif qui pousse à expliquer une situation par les caractéristiques d'une personne plutôt que par le contexte. Il dénonce la mythologie du “si tu veux, tu peux” qui ignore les facteurs systémiques.
- Ensuite, il rappelle que le Code du travail français établit un lien de subordination où la responsabilité de la santé des salariés incombe à l'employeur. Le salarié peut être acteur de sa santé, mais l'employeur est le metteur en scène.
💡 Il utilise une métaphore pour illustrer l'importance stratégique des RH : la fonction RH est la charpente de l'entreprise. Invisible de l'extérieur, elle est pourtant essentielle à la solidité de l'ensemble. La décision de bien positionner cette fonction appartient donc aux dirigeants, qui doivent la placer au même niveau hiérarchique que la direction financière, car la gestion du capital humain est tout aussi fondamentale que celle du capital économique pour la création de valeur.
Les solutions collectives : repositionner, former et ressourcer la fonction RH
Adrien entame la réflexion sur les solutions collectives en revenant au point crucial du positionnement.
La première action qu'un employeur doit entreprendre est de définir clairement la place de la fonction RH dans l'organigramme, car cette position détermine son pouvoir d'action et son influence.
Poursuivant sa réflexion sur les solutions à l'échelle de l'entreprise, Adrien commence par revaloriser le terme de support. Il soutient qu'être une fonction support n'a rien de honteux ; au contraire, le mot anglais support signifie soutenir, étayer, aider. Et c’est tout à fait noble.
La fonction RH est donc cette charpente qui permet à l'entreprise d'accomplir sa mission de création de valeur.
La première étape collective consiste donc à changer la représentation de cette fonction pour la positionner à sa juste place, celle d'un business partner stratégique, un rôle dont l'efficacité a été prouvée.
Deuxièmement, il insiste sur la nécessité de sortir d'une vision mièvre de la fonction RH, qui la réduit à la gentillesse et aux "soft skills".
Il martèle : “Je ne veux pas des RH qui soient gentils, je veux des RH qui soient compétents”. Comparant la situation à celle d'un chirurgien, il affirme que les compétences techniques et la maîtrise des fondamentaux du métier sont indispensables. Or, les professionnels RH sont souvent laissés pour compte en matière de formation et de développement de carrière, alors même qu'ils gèrent des situations humaines extrêmement lourdes (harcèlement, suicides, agressions). En absorbant la toxicité de l'organisation sans soutien adéquat, ils deviennent des toxic handlers, contraints de fonctionner en mode MacGyver avec des moyens dérisoires.
Adrien résume ainsi la solution collective en trois piliers fondamentaux.
- Premièrement, un positionnement structurel adéquat au plus haut niveau de l'organisation.
- Deuxièmement, un investissement massif dans la formation continue pour que l'intention se traduise en action compétente et sereine, face à un environnement légal et social en constante évolution.
- Troisièmement, l'allocation de ressources suffisantes (humaines, financières, sociales). Ce dernier point inclut la mise en place d'un dialogue social de qualité, qu'il qualifie, en citant l'ANACT, de meilleur garant de la réussite des actions en entreprise. Il appuie ce point de son expérience personnelle, ayant été à la fois délégué du personnel et dirigeant.
💬 Une personne dans l’audience soulève alors une objection cruciale qui met en lumière la principale faiblesse de ces solutions collectives. Elle fait remarquer que toutes ces propositions — repositionnement, formation, ressources — dépendent entièrement de la volonté et de la conviction de la direction générale. La question reste donc entière pour le professionnel RH individuel : que faire si la direction n'est pas convaincue ? Sans cet appui au sommet, le professionnel RH continue de subir la situation, privé des moyens et de la considération nécessaires pour exercer correctement sa mission.

Des solutions structurelles contre la surconnexion
La discussion revient sur les solutions concrètes que les employeurs peuvent mettre en place. Séverine oppose les mesures superficielles, comme offrir des cours de yoga, à des actions structurelles qui s'attaquent à la racine du problème de la surconnexion par exemple.
Elle critique vivement la pratique courante consistant à ajouter une mention sur le droit à la déconnexion en bas des emails, la qualifiant de symbole de l'inaction : l'entreprise se dédouane, mais le manager qui envoie un email à 22 heures continue d'exercer une pression implicite, créant un décalage entre les proclamations et la réalité.
Pour illustrer ce que sont de véritables actions, elle donne deux exemples forts. Le premier est celui de Volkswagen, qui a pris la décision radicale de bloquer l'accès aux serveurs pour une partie de ses salariés durant les soirées et les week-ends, réglant ainsi le problème à la source. Le second est celui de Daimler et son opération “Mail on Holiday”, qui efface automatiquement les emails reçus par un employé pendant ses congés et redirige l'expéditeur vers un autre contact. Séverine souligne que ces exemples, bien que spécifiques, montrent la différence fondamentale entre les bonnes intentions et des outils concrets qui transforment ces intentions en actions réelles et efficaces.
La primauté de la prévention systémique sur les actions individuelles
Adrien renforce ce point avec des arguments scientifiques. Il cite une étude de l’Université d’Oxford menée sur 40 000 salariés qui démontre que les actions de bien-être 100 % individuelles n'ont, au mieux, aucun effet sur la santé mentale et, au pire, dégradent la relation managériale. Il met en garde contre le piège des bonnes intentions, rappelant que l'enfer en est pavé. L'objectif ne doit pas être de simplement vouloir bien faire, mais de mettre en œuvre des solutions dont les bénéfices sont prouvés, sous peine de tomber dans l'abus de faiblesse ou le charlatanisme.
Il qualifie les exemples de Volkswagen et Daimler de prévention primaire, une approche qui s'attaque aux causes organisationnelles des risques psychosociaux plutôt que d'individualiser le problème.
📌 Il introduit la Courbe de Bradley, un modèle qui mesure la maturité d'une organisation en matière de prévention. Les organisations les plus immatures sont réactives et n'utilisent que des mesures individuelles (comme dire à un ouvrier de mettre ses chaussures de sécurité dans une usine dangereuse). Les organisations les plus matures, à l'inverse, sont proactives et agissent de manière systémique en créant des règles et des normes qui protègent l'ensemble du collectif.

La courbe se décompose en quatre phases distinctes, chacune représentant un niveau de maturité de la culture sécurité :
- Phase Réactive : La sécurité par instinct
- Comportement : La sécurité est vue comme une contrainte. Les employés ne respectent les règles que par peur de la sanction.
- Croyance : "Les accidents sont inévitables, c'est une question de malchance."
- Résultat : Le taux d'accidents est élevé et imprévisible. On réagit aux accidents après qu'ils se soient produits.
- Phase Dépendante : La sécurité par la supervision
- Comportement : Les employés commencent à suivre les règles parce que la direction l'exige et les surveille. La sécurité est l'affaire des managers et des responsables HSE (Hygiène, Sécurité, Environnement).
- Croyance : "Je serai en sécurité si je suis les règles et si on me dit quoi faire."
- Résultat : Le nombre d'accidents commence à diminuer de manière significative à mesure que la conformité augmente.
- Phase Indépendante : La sécurité par la prise de conscience personnelle
- Comportement : Chaque employé prend personnellement la responsabilité de sa propre sécurité. Il a intégré les règles et agit de manière sûre par conviction personnelle.
- Croyance : "Je suis responsable de ma propre sécurité."
- Résultat : Le taux d'accidents continue de baisser. Les individus sont vigilants pour eux-mêmes.
- Phase Interdépendante : La sécurité par l'engagement collectif
- Comportement : Les employés ne se contentent plus d'assurer leur propre sécurité, mais veillent activement à celle de leurs collègues. La sécurité devient une valeur fondamentale du groupe. On se sent à l'aise pour intervenir si un collègue prend un risque.
- Croyance : "Nous sommes tous responsables de la sécurité de chacun."
- Résultat : C'est le stade le plus avancé. Le taux d'accidents tend vers zéro. L'entreprise atteint l'excellence en matière de sécurité.

Le pouvoir de l'exemplarité : les leaders comme modèles
Adrien s'appuie sur un principe fondamental des sciences humaines : les gens ne font pas ce que vous dites, les gens font ce que vous faites. Il utilise l'analogie du parent qui interdit le chocolat à son enfant tout en en ayant plein la bouche, soulignant la perte de crédibilité immédiate.
Dans un contexte professionnel, ce principe est amplifié par l'autorité hiérarchique : les actions d'un manager ont infiniment plus de poids que ses paroles. Un manager qui prône la déconnexion mais envoie des emails le week-end envoie un message contradictoire et délétère.
Le repos, un pilier de la performance durable
Adrien critique la mythification des dirigeants et des personnalités politiques qui se vantent de peu dormir. Cette glorification du surmenage est une mystification qui envoie un message néfaste à tous, en particulier aux jeunes, et nie le besoin humain fondamental de repos.
S'appuyant sur son expérience de formateur de préparateurs mentaux pour sportifs de haut niveau, Adrien souligne un principe essentiel : le repos fait partie de l'entraînement.
📌 La performance durable n'est pas une question d'effort continu, mais d'une gestion intelligente de l'effort et de la récupération. On peut courir un marathon, mais pas trois d'affilée sans se détruire. Il cite l'expression Performance under pressure (la performance sous pression) pour découvrir les secrets scientifiques de la performance durable, suggérant que la clé réside dans la gestion de l'énergie et la prise en compte du repos, et non dans l'endurance à tout prix.
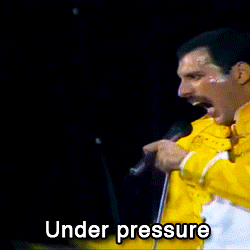
La récupération fréquente, secret de la performance durable
Adrien révèle que le secret scientifique de la performance durable sous pression est la fréquence de la récupération. Pour expliquer comment restaurer l'énergie mentale, il introduit la Théorie de la Restauration de l'Attention (Attention Restoration Theory - ART). Il explique que des heures de concentration intense devant un ordinateur provoquent une fatigue de l'attention dirigée, épuisant nos capacités cognitives. Il utilise une analogie : notre cerveau est une Ferrari, mais avec un réservoir de seulement trois litres. Une fois vide, nos fonctions exécutives supérieures (prise de décision complexe, réflexion stratégique) déclinent.
La solution scientifiquement prouvée pour recharger ce réservoir est une action individuelle simple : marcher 45 minutes chaque jour à la mi-journée. Pour un effet maximal, cette activité physique doit se dérouler dans un cadre naturel, les conversations doivent porter sur des sujets légers et non professionnels, et elle doit être partagée avec une personne appréciée. Les résultats sont spectaculaires : cette pratique augmente la performance cognitive de l'après-midi de plus de 50 % et réduit considérablement la fatigue attentionnelle. Adrien témoigne personnellement de l'efficacité de cette méthode, qu'il applique depuis 12 ans. Il ajoute que cette habitude favorise également la diffusion cognitive, un processus qui permet de prendre du recul émotionnel par rapport aux problèmes du quotidien.
Le principe de la fréquence contre l'intensité
Adrien conclut sa démonstration en soulignant que la valeur se crée non pas par le nombre d'heures travaillées, mais par la performance durant ces heures. Bien que les solutions structurelles soient primordiales, les actions individuelles comme la marche quotidienne sont un complément essentiel. L'animatrice fait alors un parallèle avec le sommeil, évoquant un principe clé qu'Adrien avait partagé : la supériorité de la fréquence sur l'intensité. Elle réalise que son habitude de compenser de courtes nuits en semaine par une grasse matinée le week-end est contre-productive. Tenter de "rattraper" le sommeil est aussi inefficace que de remplacer une récupération fréquente par des pauses rares mais longues ; le corps et l'esprit ont besoin de régularité.
Les multiples dimensions de la fatigue et du repos
Séverine rebondit sur cette réflexion en proposant d'élargir la définition du repos au-delà du simple sommeil. Elle note que beaucoup de gens sacrifient leur sommeil car c'est le seul moment qu'ils ont pour eux, et que pour certains, comme les insomniaques, dormir n'est tout simplement pas une option sur commande.
Elle introduit alors le cadre d'analyse de la docteure Saundra Dalton-Smith, qui, bien que relevant du développement personnel, offre une grille de lecture intéressante en identifiant différents types de fatigue qui appellent différents types de repos.
Elle énumère plusieurs de ces fatigues :
- physique (manque de sommeil),
- sensorielle (sur-sollicitation par les écrans, le bruit),
- mentale (surcharge cognitive),
- émotionnelle (gestion des émotions des autres, particulièrement pertinente pour les RH),
- créative (pression constante pour innover),
- sociale (interactions énergivores et imprévues),
- et spirituel (sentiment de manque d’appartenance, d'acceptation, de sens).
Selon Séverine, cette typologie est doublement utile. D'une part, elle met en évidence les causes structurelles de l'épuisement, déculpabilisant l'individu. D'autre part, elle ouvre la voie à des solutions de repos ciblées et variées, adaptées à la nature de la fatigue ressentie.
Des actions individuelles ciblées et un changement d'état d'esprit
Poursuivant l'exploration des différents types de repos, Séverine suggère des solutions ciblées que propose la docteure Saundra Dalton-Smith pour chaque type de fatigue.
- Contre la fatigue sensorielle, elle préconise des pauses silencieuses et une limitation du temps d'écran.
- Pour la fatigue créative, elle recommande des activités créatives sans objectif de productivité.
- Face à la fatigue émotionnelle, il est crucial d'apprendre à dire non et de trouver des exutoires pour exprimer ses émotions.
- Enfin, pour contrer la fatigue sociale, elle conseille de limiter les interactions énergivores et de s'aménager des moments de solitude.
Tout en reconnaissant les limites de ces solutions individuelles, elle estime que cette approche nuancée permet de sortir de la réponse simpliste qui consiste à, par exemple, prendre un jour de congé.
Anaïs complète ce volet en citant une newsletter de Séverine qui met en avant un autre type d'action individuelle : un changement d'état d'esprit. Il s'agit de décider que l'on mérite mieux, de s'autoriser à considérer sa souffrance comme légitime et grave, de se faire aider et de cesser de se comparer aux récits de succès idéalisés. Bien que cette prise de conscience soit fondamentale, tous conviennent qu'elle n'est pas simple à mettre en œuvre.
Le collectif comme remède à l'isolement
Séverine insiste sur le fait que les solutions individuelles, bien que nécessaires en l'absence de soutien de l'entreprise, ne sont pas le cœur du sujet.
Pour elle, la solution la plus puissante réside dans le collectif. Elle décrit le monde du travail actuel comme étant archipélisé, où chaque individu est isolé dans sa performance et ses difficultés. Cette solitude est particulièrement prononcée pour la fonction RH, qui occupe une position intermédiaire et souvent solitaire, entre la direction et les salariés.
La clé est donc de briser cet isolement en se connectant avec des pairs. Le fait de pouvoir partager son vécu avec des personnes qui vivent des situations similaires permet de trouver de l'empathie, de réaliser que l'on n'est pas seul et, surtout, que l'on n'est pas entièrement responsable de sa situation, car les causes sont avant tout structurelles. Elle considère cette connexion au collectif comme le préalable indispensable à toute forme de soin et de transformation.

Se ressourcer activement grâce au soutien des pairs
Adrien enrichit la discussion en distinguant “se reposer” (une action passive comme dormir) de “se ressourcer” (une action délibérée et active). Se ressourcer, c'est agir en accord avec ses valeurs et ce qui nous est précieux, loin des injonctions des réseaux sociaux. Il critique vivement l'effet dépressogène des illusions comparatives véhiculées par des plateformes comme Instagram, qui ne montrent qu'un marketing de soi culpabilisant. Il rappelle qu'au-delà d'un certain niveau de revenus, le bonheur durable provient principalement de la qualité des liens avec nos proches.
Appliquant ce principe aux RH, il affirme que le premier rempart contre la détresse psychologique est le soutien des pairs. Il leur conseille de créer leur propre village d'Astérix : une communauté soudée où ils peuvent prendre soin les uns des autres.
Ce soutien actif passe par le partage d'expériences, l'écoute de conférences, la lecture, et le simple fait de prendre l'air ensemble pour amener un peu de nouveauté. En se connectant, les professionnels RH réalisent que leurs difficultés sont partagées, ce qui crée une normalisation positive, déculpabilise et permet de prendre de la distance, voire de trouver de l'humour dans des situations difficiles.
La communauté comme action individuelle et la valeur de la prévention
Anaïs conclut en validant l'importance des communautés de pairs, notant qu'elle observe une nette différence de bien-être entre les professionnels RH isolés et ceux qui participent activement à des réseaux. Rejoindre une communauté est donc une action que l'on peut initier seul, précisément dans le but de ne plus l'être.
💬 La discussion est ensuite ponctuée par une réaction pertinente de l'audience, qui souligne que la glorification en entreprise des gestionnaires de crise est néfaste. Il est préférable de valoriser les leaders prévoyants qui évitent les crises, même si leur travail est moins spectaculaire que celui des héros qui s'épuisent dans l'action. La prévention, bien que peu glamour, est absolument essentielle.
Mots de fin et ressources pour agir
Pour conclure, Séverine, Adrien et Anaïs partagent des ressources.
Adrien Chignard recommande d'abord un livre qui a changé sa vie : “Le bonheur, désespérément” d'André Comte-Sponville. Il en retient une idée forte : passer de l'espoir passif à la volonté active, en reprenant en main son pouvoir d'agir.

Ensuite, inspiré par les arguments de Séverine, il choisit de mettre l'accent sur une ressource sociale plutôt qu'un outil individuel. Il partage une pratique de management personnelle : avec son équipe, il instaure un temps dédié pour “bitcher ensemble”, c'est-à-dire se plaindre collectivement et sans filtre des frustrations du quotidien (clients difficiles, tâches pénibles, etc.). Loin d'être une simple séance de défoulement, cette pratique vise à créer un climat de sécurité psychologique. Elle permet aux membres de l'équipe d'évacuer le stress entre eux, au sein d'un groupe qui partage le même contexte, plutôt que de le déverser sur leur entourage personnel. Cette habitude renforce les liens du groupe, permet de prendre de la distance grâce à l'humour et confirme que personne n'est seul face aux difficultés, ce qui, au final, augmente la cohésion et la performance collective.
Anaïs conclut en ajoutant 2 ressources :
- “Bien dans votre job: Les 25 astuces du psy... pour éviter d'aller le voir”
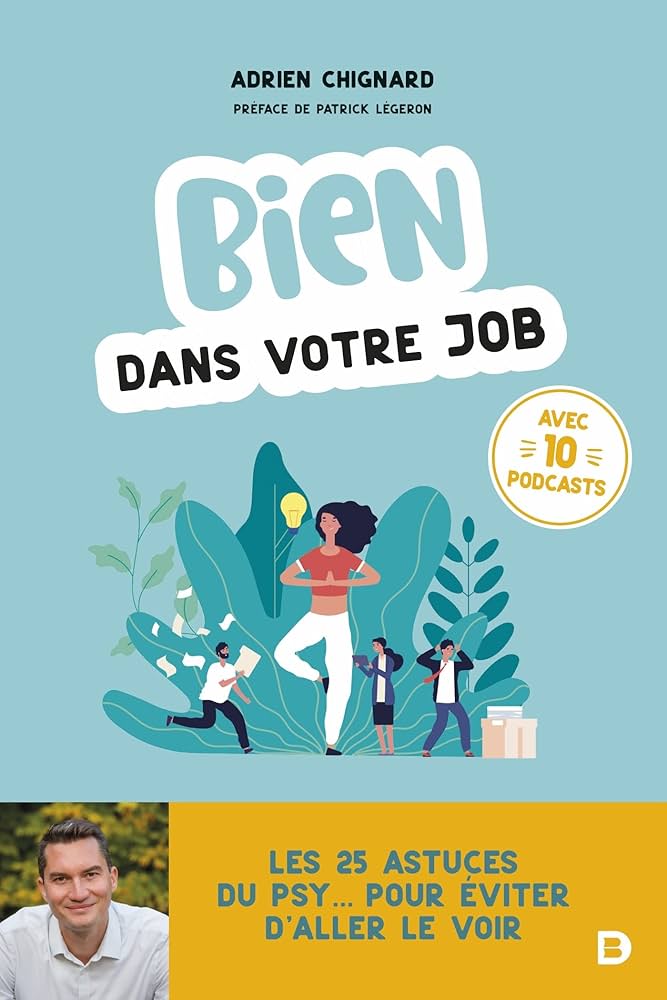
- La newsletter de Séverine, CDLT

Et bien sûr toutes les ressources du blog de Taleez qui vous ont été proposées tout le long de cette synthèse.



.png)
.jpg)
.png)


